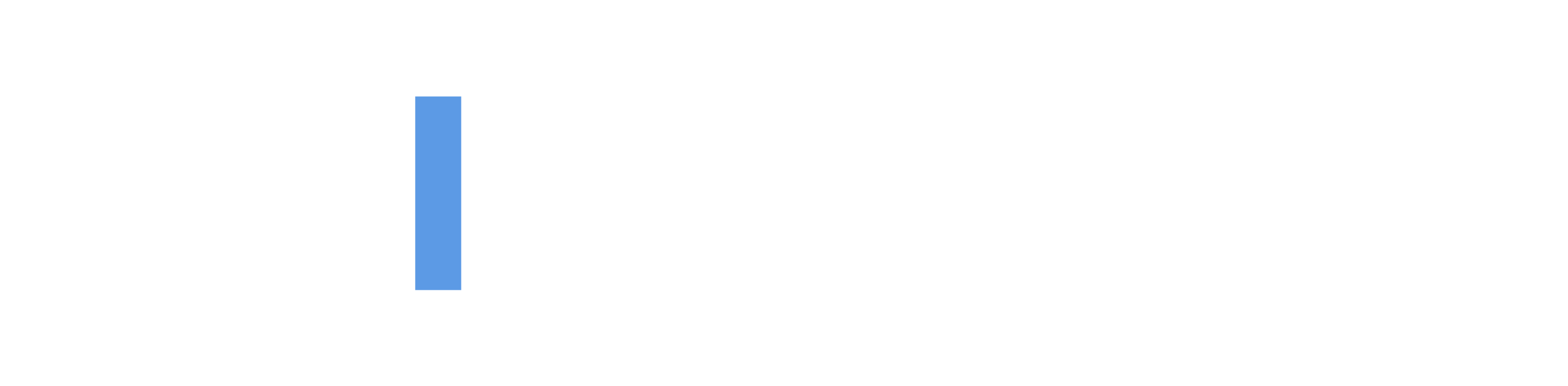À Aleria, une famille d’agriculteurs relève un défi inattendu : faire pousser de la canne à sucre sur l’île. Une expérimentation réussie, qui pourrait bien ouvrir la voie à une nouvelle filière agricole, plus résiliente face au changement climatique.
La Corse détient, semble-t-il, un record : celui du territoire européen le plus haut en latitude, sur lequel ont été réalisées avec succès des plantations de canne à sucre. Même s’il en pousse également dans le sud de l’Espagne, c’est sans conteste quelque chose d’inattendu chez nous. Comment imaginer que ces plantes du bout du monde puissent s’adapter sous nos climats ? Si la famille Lavergne-Vincentelli s’est intéressée au sujet, c’est un peu le fait du hasard. Et l’histoire en remonte des années en arrière, quand un jeune ingénieur, Christophe Poser, effectuait un stage sur le domaine. « C’était du temps de mon grand-père », raconte Antoine, qui, avec sa sœur Andrea, travaille aujourd’hui dans la ferme – la cinquième génération ! Personne n’entend plus parler de lui jusqu’à un jour de 2022 où il passe un coup de téléphone : « Je voudrais implanter de la culture de canne à sucre sur votre domaine ! ». Christophe Poser est chercheur au CIRAD de Montpellier. Il a déjà entrepris des essais dans le sud de la France, sur cinq domaines, et envisage une dernière implantation en Corse.
« On aime explorer ! »
Rien ne prédisposait particulièrement le domaine de Padulone à l’expérimentation agricole. Il était né au XIXe siècle : Napoléon III qui multipliait les initiatives pour développer la Corse, y avait intéressé un groupe d’investisseurs parisiens, qui y avaient planté de la vigne. La fin du second Empire avait signé celle de l’exploitation, insuffisamment rentable. Et de fil en aiguille, de vente en revente, le domaine avait fini par échoir, dans l’entre-deux-guerres, à la famille Vincentelli. Elle y cultivait la vigne : une culture qui représente toujours le socle de cette exploitation de 300 hectares. Les Lavergne-Vincentelli y élèvent également des vaches – vaches limousines et Kuroge wagyu. Et plus récemment, ils y ont planté des oliviers : un choix mûrement réfléchi pour une forme de polyculture, dans une démarche qui se veut résolument écologique, au sens raisonné du terme. Alors de la canne à sucre ? « Quand on nous propose quelque chose, on dit tout de suite “oui”, s’enthousiasme Antoine. On est des gens curieux. On aime explorer ! »
Anticiper l’évolution du climat
La canne à sucre a besoin de deux choses pour pousser : des températures suffisamment élevées – le gel la tue. Et de l’eau : « Mais pas plus que pour la vigne ». L’eau, on n’en manque guère en Corse, d’autant qu’il sera toujours possible de retenir, dans l’avenir, celle qui tombe du ciel en quantité et qui, aujourd’hui, file à la mer. Car l’enjeu est là : « Quand j’étais enfant, en hiver, on s’amusait à casser les plaques de glace sur les flaques, dans le domaine. Cela fait plus de vingt ans que cela n’arrive plus. Il faut nous adapter à ce changement. Trouver des leviers... » La vigne ou l’élevage commencent à souffrir de cette évolution climatique, mais la canne à sucre, elle, s’en porte bien. C’est du moins ce dont témoigne l’essai qui est tenté avec l’appui du CIRAD. Si en 2022, « on a planté trop tôt, avec des pousses trop petites », la deuxième tentative en 2023, est une réussite. Au point que de toutes les expérimentations tentées par le CIRAD, seule celle effectuée en Corse tire son épingle du jeu : les cinq plantations continentales meurent sous l’effet du gel. « Christophe était ravi. Et nous aussi ! En fait, c’est la culture parfaite. En Corse, c’est un bonheur ! »
« On aime explorer ! »
Rien ne prédisposait particulièrement le domaine de Padulone à l’expérimentation agricole. Il était né au XIXe siècle : Napoléon III qui multipliait les initiatives pour développer la Corse, y avait intéressé un groupe d’investisseurs parisiens, qui y avaient planté de la vigne. La fin du second Empire avait signé celle de l’exploitation, insuffisamment rentable. Et de fil en aiguille, de vente en revente, le domaine avait fini par échoir, dans l’entre-deux-guerres, à la famille Vincentelli. Elle y cultivait la vigne : une culture qui représente toujours le socle de cette exploitation de 300 hectares. Les Lavergne-Vincentelli y élèvent également des vaches – vaches limousines et Kuroge wagyu. Et plus récemment, ils y ont planté des oliviers : un choix mûrement réfléchi pour une forme de polyculture, dans une démarche qui se veut résolument écologique, au sens raisonné du terme. Alors de la canne à sucre ? « Quand on nous propose quelque chose, on dit tout de suite “oui”, s’enthousiasme Antoine. On est des gens curieux. On aime explorer ! »
Anticiper l’évolution du climat
La canne à sucre a besoin de deux choses pour pousser : des températures suffisamment élevées – le gel la tue. Et de l’eau : « Mais pas plus que pour la vigne ». L’eau, on n’en manque guère en Corse, d’autant qu’il sera toujours possible de retenir, dans l’avenir, celle qui tombe du ciel en quantité et qui, aujourd’hui, file à la mer. Car l’enjeu est là : « Quand j’étais enfant, en hiver, on s’amusait à casser les plaques de glace sur les flaques, dans le domaine. Cela fait plus de vingt ans que cela n’arrive plus. Il faut nous adapter à ce changement. Trouver des leviers... » La vigne ou l’élevage commencent à souffrir de cette évolution climatique, mais la canne à sucre, elle, s’en porte bien. C’est du moins ce dont témoigne l’essai qui est tenté avec l’appui du CIRAD. Si en 2022, « on a planté trop tôt, avec des pousses trop petites », la deuxième tentative en 2023, est une réussite. Au point que de toutes les expérimentations tentées par le CIRAD, seule celle effectuée en Corse tire son épingle du jeu : les cinq plantations continentales meurent sous l’effet du gel. « Christophe était ravi. Et nous aussi ! En fait, c’est la culture parfaite. En Corse, c’est un bonheur ! »
Une culture idéale !
Et pour cause ! Les plants qui ont une durée de vie d’environ vingt ans, sont conçus in vitro par le laboratoire vitropic. Cinq variétés différentes venues de la Réunion sont testées à Aleria, élaborées en lien avec le centre de recherche eRcane. L’avantage de la technique est évident : les plants sont exempts de maladies et de ravageurs « C’est le plus important pour introduire une nouvelle culture. » En conséquence, pas besoin de pesticides ! Les herbicides sont tout aussi inutiles, tant la densité des plants empêche les mauvaises herbes de pousser. On ne leur donne que de l’eau. « Et lorsqu’on coupe, cela fait un couvert végétal... qui empêche également une trop grande évaporation. »
Ajoutez à cela que la plante est utilisable à plus de 80 %, ce qui ouvre encore d’autres opportunités économiques : outre le jus, le broyat a de multiples applications possibles. On peut en faire des briquettes qui servent de combustibles, mais aussi des plaques isolantes ou des ustensiles – assiettes, pailles, et autres accessoires. « Nous avons commencé à travailler avec une entreprise italienne. Mais pour l’instant la production est insuffisante. Il faut un rendement en matières plus important... » Cela viendra peut-être assez vite. Car si la plantation ne couvre aujourd’hui qu’un petit hectare, tout au long de la voie romaine, comme les fouilles préventives l’ont montré, « nous prévoyons de doubler la surface tous les ans », en mécanisant éventuellement la récolte : un travail physique et dévoreur de temps.
Du rhum corse !
Mais avant de songer aux coproduits, ce qui vient d’abord à l’esprit, c’est la fabrication de rhum. Dès la deuxième récolte, réalisée conjointement avec le CIRAD pour effectuer les tests scientifiques, Christophe Lavergne demande l’autorisation d’utiliser la matière première. La ferme s’équipe : le matériel sud-américain est beaucoup trop cher, et c’est un moulin chinois qui va effectuer le broyage à “grande” échelle – le broyeur utilisé pour les essais étant trop petit. Il est complété par du matériel de récupération qui permet de confectionner une micro-usine destinée à récupérer le jus. Quant à la distillation, elle se fait dans un alambic reconditionné, dont le système de chauffe, inventé par Capovilla, « un ponte de la distillation italienne », fonctionne avec un bain-marie... chauffé au bois de récupération : un petit bijou tout rutilant qui allie qualité, productivité et écologie.
Du rhum épicé... au vieux-rhum
Côté fermentation du jus, les Lavergne-Vincentelli maîtrisent : « C’est exactement comme du vin. » Or, le vin, c’est à la fois leur formation – à l’exception d’Antoine qui est un ancien journaliste – et leur métier de base. En 2023, avec leurs 540 bouteilles ou peu s’en faut, ils n’ont pas suffisamment de production pour faire vieillir leur produit : ils confectionnent un rhum épicé « qui reprend un peu la typicité des rhums vieux », avec vanille, fève tonka, cacao, caramel et agrumes, et en recourant au maximum aux produits locaux. Mais comme en 2024, la France interdit l’appellation de rhum épicé aux rhums contenant des épices, ils sont « obligés de changer les étiquettes ! ». La récolte en cours, en revanche, permettra d’envisager le vieillissement : « Six mois, ou un peu plus... dans d’anciens fûts de Niellucciu », avec une production également de rhum blanc, en fonction des arômes et des caractéristiques obtenues à chaque distillation. Des produits qui seront essentiellement vendus en direct, compte tenu toujours des volumes en jeu. Le surcoût d’une distribution plus large serait prohibitif, d’autant que le rhum corse est exclu des avantages fiscaux dont bénéficie celui des Antilles.
Produire du rhum, certes. Mais le sucre ? Ils y songent également : ils ont déjà travaillé avec des “Meilleurs Ouvriers de France”, sur le rapajura, cette pâte sucrée si recherchée : « Ils ont adoré ! » Alors, pourquoi pas ? Ce ne sont pas les idées qui manquent : « La Corse a beaucoup de potentiel », assure Antoine, conscient qu’on peut véritablement créer des richesses économiques sur notre île. La famille a manifestement la volonté d’y contribuer.
Et pour cause ! Les plants qui ont une durée de vie d’environ vingt ans, sont conçus in vitro par le laboratoire vitropic. Cinq variétés différentes venues de la Réunion sont testées à Aleria, élaborées en lien avec le centre de recherche eRcane. L’avantage de la technique est évident : les plants sont exempts de maladies et de ravageurs « C’est le plus important pour introduire une nouvelle culture. » En conséquence, pas besoin de pesticides ! Les herbicides sont tout aussi inutiles, tant la densité des plants empêche les mauvaises herbes de pousser. On ne leur donne que de l’eau. « Et lorsqu’on coupe, cela fait un couvert végétal... qui empêche également une trop grande évaporation. »
Ajoutez à cela que la plante est utilisable à plus de 80 %, ce qui ouvre encore d’autres opportunités économiques : outre le jus, le broyat a de multiples applications possibles. On peut en faire des briquettes qui servent de combustibles, mais aussi des plaques isolantes ou des ustensiles – assiettes, pailles, et autres accessoires. « Nous avons commencé à travailler avec une entreprise italienne. Mais pour l’instant la production est insuffisante. Il faut un rendement en matières plus important... » Cela viendra peut-être assez vite. Car si la plantation ne couvre aujourd’hui qu’un petit hectare, tout au long de la voie romaine, comme les fouilles préventives l’ont montré, « nous prévoyons de doubler la surface tous les ans », en mécanisant éventuellement la récolte : un travail physique et dévoreur de temps.
Du rhum corse !
Mais avant de songer aux coproduits, ce qui vient d’abord à l’esprit, c’est la fabrication de rhum. Dès la deuxième récolte, réalisée conjointement avec le CIRAD pour effectuer les tests scientifiques, Christophe Lavergne demande l’autorisation d’utiliser la matière première. La ferme s’équipe : le matériel sud-américain est beaucoup trop cher, et c’est un moulin chinois qui va effectuer le broyage à “grande” échelle – le broyeur utilisé pour les essais étant trop petit. Il est complété par du matériel de récupération qui permet de confectionner une micro-usine destinée à récupérer le jus. Quant à la distillation, elle se fait dans un alambic reconditionné, dont le système de chauffe, inventé par Capovilla, « un ponte de la distillation italienne », fonctionne avec un bain-marie... chauffé au bois de récupération : un petit bijou tout rutilant qui allie qualité, productivité et écologie.
Du rhum épicé... au vieux-rhum
Côté fermentation du jus, les Lavergne-Vincentelli maîtrisent : « C’est exactement comme du vin. » Or, le vin, c’est à la fois leur formation – à l’exception d’Antoine qui est un ancien journaliste – et leur métier de base. En 2023, avec leurs 540 bouteilles ou peu s’en faut, ils n’ont pas suffisamment de production pour faire vieillir leur produit : ils confectionnent un rhum épicé « qui reprend un peu la typicité des rhums vieux », avec vanille, fève tonka, cacao, caramel et agrumes, et en recourant au maximum aux produits locaux. Mais comme en 2024, la France interdit l’appellation de rhum épicé aux rhums contenant des épices, ils sont « obligés de changer les étiquettes ! ». La récolte en cours, en revanche, permettra d’envisager le vieillissement : « Six mois, ou un peu plus... dans d’anciens fûts de Niellucciu », avec une production également de rhum blanc, en fonction des arômes et des caractéristiques obtenues à chaque distillation. Des produits qui seront essentiellement vendus en direct, compte tenu toujours des volumes en jeu. Le surcoût d’une distribution plus large serait prohibitif, d’autant que le rhum corse est exclu des avantages fiscaux dont bénéficie celui des Antilles.
Produire du rhum, certes. Mais le sucre ? Ils y songent également : ils ont déjà travaillé avec des “Meilleurs Ouvriers de France”, sur le rapajura, cette pâte sucrée si recherchée : « Ils ont adoré ! » Alors, pourquoi pas ? Ce ne sont pas les idées qui manquent : « La Corse a beaucoup de potentiel », assure Antoine, conscient qu’on peut véritablement créer des richesses économiques sur notre île. La famille a manifestement la volonté d’y contribuer.